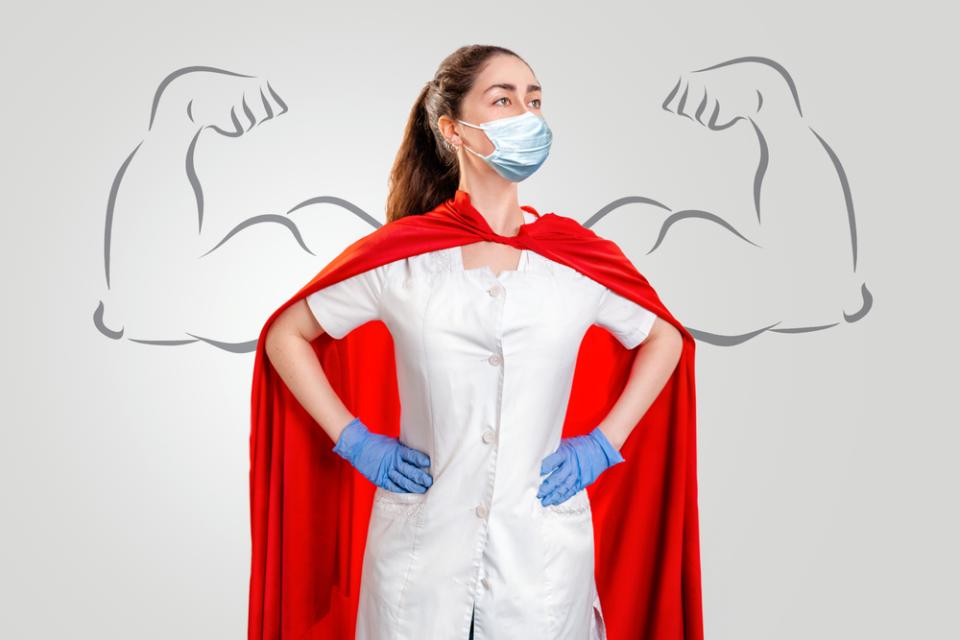Que peut apprendre la Belgique des initiatives internationales pour renforcer la profession infirmière

1. Garantir des ratios sécurisés et des effectifs suffisants
Les effectifs infirmiers, dimension cruciale pour la qualité des soins et la rétention du personnel, font l’objet d’initiatives concrètes dans plusieurs pays. Le Parlement européen, via son comité SANT, insiste depuis 2025 sur l’instauration de normes de safe staffing, à mettre en œuvre dans tous les États membres. Selon son rapport, il ne suffit plus de formuler des recommandations : il faut des politiques légales contraignantes pour assurer des niveaux d’effectifs appropriés et soutenir le personnel sur le terrain.
En Belgique, le KCE (Centre fédéral d’expertise des soins de santé) a publié, en 2021, une deuxième édition de son rapport sur le sujet, comparant les ratios belges à ceux d’autres pays développés. Ce document suggère d’adopter des standards européens pour sécuriser le nombre d’infirmiers aux prises en charge directes et ainsi réduire la surcharge clinique.
2. Développer un environnement professionnel attractif
Une vaste littérature scientifique converge sur un point : améliorer les conditions de travail — via un cadre professionnel sécurisant, une gestion du stress, un leadership positif et une organisation flexible — est essentiel pour retenir le personnel soignant. Une étude de synthèse européenne sur la rétention identify des « bundles » de mesures : staffing adéquat, formation continue, perspectives de carrière, conditions de travail favorables, reconnaissance, autonomie dans le rôle et management de proximité .
Un exemple récent aux États-Unis, cité dans la revue Health Leaders, confirme qu’un environnement de travail inclusif — offrant flexibilité, résidences infirmières pour jeunes diplômés et gouvernance partagée — permet de faire chuter le turnover de 30 % à environ 6–10 % . Ces leviers organisationnels pourraient être adaptés dans les établissements belges pour favoriser le bien-être des soignants, les fidéliser et limiter les départs, notamment en début de carrière.
3. Mettre en œuvre des programmes de formation et résidences de transition
La période de transition entre formation initiale et pratique active constitue un moment critique : jusqu’à 30 % des jeunes diplômés quittent le métier dans les deux premières années. Pour y remédier, certaines institutions ont mis en place des « nurse residencies », des programmes de mentorat prolongés, alternant théorie et pratique, permettant aux novices d’être accompagnés pas à pas, avec un binôme senior pour les premières semaines.
Aux États-Unis, ces programmes ont démontré leur efficacité : diminution spectaculaire du turnover, augmentation de la confiance et de la satisfaction au travail. Une telle approche pourrait être intégrée dans les plans fédéraux et régionaux belges, en étroite collaboration avec les hôpitaux et écoles d’infirmières.
4. Investir dans l’éducation, la formation continue et la carrière
Les professionnels de santé expriment un fort désir d’évolution et de reconnaissance professionnelle. Un journal spécialisé souligne que les hôpitaux dits "performants" favorisent la formation continue, les passerelles entre diplômes (collèges, bachelor…) et la progression de carrière ; tandis que les structures plus fragiles ne valorisent pas ces voies, entraînant frustration et perte de sens.
En Belgique, renforcer les cursus modulaires — permettant aux infirmières de monter en compétences à leur rythme — et proposer des parcours de spécialisation serait un moyen d’ancrer les infirmiers dans une trajectoire motivante, investie et pérenne.
5. Respecter le recrutement éthique et les flux internationaux
Depuis le COVID-19, les pays à forte demande se tournent massivement vers les professionnels étrangers. Une enquête de mai 2025 révèle que 3 infirmiers sur 5 en Europe sont nés hors du pays d’emploi et que l’Europe absorbe une partie de la pénurie de 5,8 millions à l’échelle mondiale.
Le Parlement européen insiste sur la nécessité de respecter le « WHO Global Code of Practice on international recruitment », encourageant les États à former prioritairement leurs propres professionnels et à faire en sorte que le recrutement international soit éthique, non prédatoire et réciproquement bénéfique.
En Belgique, près de 4,2 % des infirmiers sont formés à l’étranger, un chiffre qui a quasi triplé en dix ans, bien qu’il reste inférieur à la moyenne européenne. Il est donc crucial d’accompagner ces professionnels — émission de titres, adaptation culturelle, soutien linguistique — tout en mettant en priorité les ressources nationales et en réduisant la dépendance au vivier international.
6. Promouvoir une gouvernance partagée et le leadership infirmier
Un des enseignements-clés observés ailleurs réside dans l’autonomisation des équipes soignantes. Les modèles de shared governance, impliquant les infirmiers dans les décisions cliniques, organisationnelles et qualité, génèrent un sentiment d’appartenance, d’engagement, d’initiative et une communication fluide entre niveaux hiérarchiques .
En Belgique, promouvoir les infirmiers comme acteurs-clés de gouvernance – via des comités mixtes, des formations en leadership, la participation aux projets de service et aux choix d’équipement, etc. – contribuerait à réduire le sentiment d’impuissance et à renforcer la motivation.
7. Participer activement aux politiques européennes et aux financements
La Belgique, en tant qu’État membre, pourrait tirer davantage profit des dispositifs européens. Le rapport SANT recommande d’utiliser le Recovery and Resilience Facility (RRF) pour financer massivement les efforts de formation, de renforcement du personnel et d’amélioration des conditions de travail — mais pour l’instant, ces fonds ne sont pas conditionnés à une allocation fixe en soins infirmiers.
En s’assurant que la Belgique consacre une part significative de son plan national à soutenir la profession infirmière, on créerait un effet levier important pour pérenniser les mesures mentionnées ci-dessus (programmes de résidence, renforcement des ratios, formation continue, etc.).
Une stratégie belge riche de l’expérience internationale
En se nourrissant des expériences et d’initiatives menées ailleurs — standards de staffing contraignants, résidences encadrées, formation modulable, recrutement éthique, gouvernance partagée — la Belgique peut affiner sa stratégie pour transformer la profession infirmière. Les défis sont multiples, mais les solutions existent : elles demandent cohérence, financement, coordination entre acteurs (pouvoirs publics, institutions de soins, établissements de formation, syndicats) et vision à long terme.
Un plan national inspiré des bonnes pratiques européennes et nord-américaines permettrait non seulement d’attirer et retenir davantage d’infirmiers, mais aussi d’améliorer la qualité des soins et la résilience de notre système de santé face aux crises à venir.